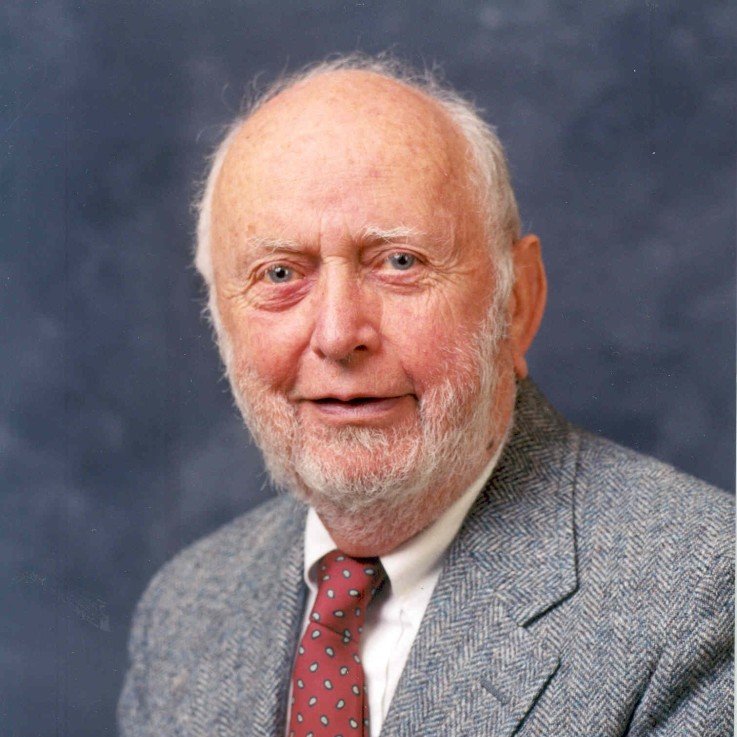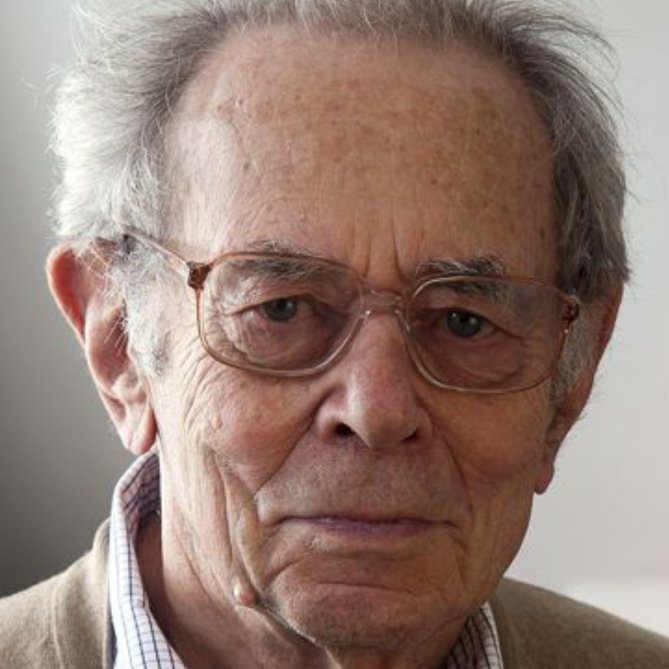Les révolutions de masse peuvent être à l’origine de progrès institutionnel.
Un thread (en deux parties) de théorie économique à partir d’une analyse de 1789 (et 1688).
Un thread (en deux parties) de théorie économique à partir d’une analyse de 1789 (et 1688).
En économie, la Révolution n’a pas bonne presse. Dans cet article avec Batifoulier et Vahabi on se demande si les Révolutions peuvent être à l’origine d’innovation institutionnelle positive ou si elles ne sont qu’une source de violence et de destruction ? https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2020-6-page-855.htm
Avertissement : l’idée ici est de reprendre les définitions les plus communément admises de la théorie économique dominante pour démontrer l’intérêt de la Révolution de masse. Je ne vais donc pas parler avec les mots des radicaux, comme Marx par exemple.
Pour le néo-institutionnaliste Douglas North, les institutions sont des interactions humaines répétées qui produisent un ordre prédictible, réduisant l’incertitude. Les institutions sont les normes formelles et informelles qui constituent les règles du jeu économico-politique.
On peut dire en miroir que les Révolutions ne sont pas des actions répétées et qu’elles ont des conséquences imprédictibles.
La différence entre réforme et révolution n’est pas liée à la temporalité (lent/rapide) ni à la méthode (pacifique/violent) mais la nature du changement.
La différence entre réforme et révolution n’est pas liée à la temporalité (lent/rapide) ni à la méthode (pacifique/violent) mais la nature du changement.
Si on suit l’économiste hongrois Janos Kornai, la révolution est un changement qualitatif de l’ordre social tandis que la réforme est un changement quantitatif – dans un cadre institutionnel relativement stable.
Le problème est que pour beaucoup d’économistes le conflit est une mauvaise chose en soi. Il est alors utile de passer par Albert Hirschman qui a redonné du crédit au conflit dans la théorie économique dans son livre Exit, voice and loyalty.
Son point de départ est le constat d’insuffisance de la coordination marchande qui ne laisse de place qu’à la stratégie exit en cas de mécontentement. Vous n’êtes pas content de votre patron ? Il faut en changer et faire jouer la concurrence.
Hirschman introduit le concept de voice (voix) : une conflictualité non violente des employés qui peut être source d’efficacité dans les entreprises. Contrairement à ce qui est accepté usuellement, les grève et manifestations peuvent produire de l’efficacité économique.
Voice est une activité conflictuelle dans le cadre des règles existantes : cela ne remet pas en cause fondamentalement les institutions (ex : droit de propriété) et cela peut engendrer des réformes utiles (ex : hausse des salaires, amélioration des conditions de travail, etc.).
Il existe cependant une ambiguïté dans la théorie d’Hirschman : voice ne s’exprime-t-il que dans le cadre des règles existantes (ex : à l'intérieur d'un régime politique) ou peut-il s’exprimer contre les règles existantes (désobéissance civile, coup d’état, révolution) ?
On propose de considérer la possibilité d’un voice contre les règles existantes comme une forme particulière d’exit : ne pas rester loyalistes (loyalty), ne pas émigrer (exit), ne pas demander de réforme (voice) ; demander la révolution comme changement radical des règles.
On propose d’appeler scream (hurlement) cette forme particulière de voice (voix) : un voice non réformateur, contre l’ordre social établit. Le scream peut améliorer l’efficacité économique lorsque le voice n’est pas possible – révolution versus réforme.
Pour North, en suivant le théorème de Coase, la négociation plutôt que le conflit est à l’origine du changement institutionnel. Dans ce cadre les comportements conflictuels n’arrivent jamais (le conflit n’est qu’une menace dans le jeu de la négociation) ou bien ils sont négatifs.
C’est pour cette raison que North considère que les révolutions d’élites sont supérieures aux révolutions de masse : les élites sont en mesure de négocier entre elles des changements institutionnels sans violence alors que l’implication des masses engendre trop de destruction.
Comment distinguer les révolutions d’élites des révolutions de masse ? Pour la sociologue Ellen Kay Trimberger, on peut définir les révolution d’élite par deux caractéristiques :
i) les leaders révolutionnaires appartiennent à la classe dominante de l’ancien régime ;
i) les leaders révolutionnaires appartiennent à la classe dominante de l’ancien régime ;
ii) le conflit et les changements sont limités et ils n’impliquent pas la participation de la masse de la population. Il y a une négociation entre élites avec une orientation nationale plutôt qu’une orientation de classe.
A l’inverse les révolutions de masse impliquent la participation forte du bas de la pyramide sociale, générant éventuellement une violence de classe et de masse. Le politiste Jack Goldstone propose une analyse similaire en parlant de révolution colorées et radicales.
Pour North les révolutions d’élites peuvent être source de changement institutionnel positif et le cas typique est la Glorious Revolution anglaise de 1688. C’est à ce moment que la souveraineté (État/politique) et la propriété (privé/économique) se sont séparés.
Contrairement à ce que pensent les néo-institutionnalistes, nous essayons de montrer que la France en 1789 est parvenue à un résultat similaire par une révolution de masse. Mais, en France, le changement s’est opéré au nom de la modernité contre la tradition.
Quelles sont les spécificités des révolutions de masse ?
i) Elles attaquent les anciennes institutions (et ne se revendiquent pas d’un ordre ancien comme pour le fascisme). Cela conduit à une remise en cause de l’Église et de l’aristocratie au nom de l’autogouvernement.
i) Elles attaquent les anciennes institutions (et ne se revendiquent pas d’un ordre ancien comme pour le fascisme). Cela conduit à une remise en cause de l’Église et de l’aristocratie au nom de l’autogouvernement.
ii) les révolutions de masse ont un fondement de classe dans lutte contre le régime en place. Si la libération nationale (face colonialisme par exemple) peut être en jeu, elles visent surtout l’élimination des privilèges socio-économiques entre ‘riches’ et ‘pauvres’.
iii) les révolutions de masse génèrent un processus de polarisation entre modérés et radicaux après le changement de régime lié au fait qu’il est plus facile de définir un agenda négatif (détruire l’ordre ancien) que de définir un agenda positif (reconstruire un ordre nouveau).
La révolution d’élite est une révolution sans révolution : les formes institutionnelles anciennes sont maintenues avec un contenu renouvelé. Le changement est négocié entre les anciennes et les nouvelles élites. L’innovation est incrémentale. Voice plutôt que scream.
En 1688 en Angleterre, l’aristocratie a réussi à éviter le scream en permettant l’ascension de la bourgeoisie. Ce repartage du pouvoir a permis d’éviter à la bourgeoisie de s’appuyer sur les classes populaires pour aller vers révolution de masse.
Dans la révolution de masse les élites nouvelles partagent leadership avec masses. Comme le souligne Lénine, l’implication des masses suppose une situation révolutionnaire :
i) une partie des classes dirigeantes désire le changement pour maintenir sa position ii) les souffrances des classes oppressées sont supérieures à l’habitude iii) l’activité politique auto-organisée des masses s’accroit.
A partir des éléments théoriques qui précèdent sur la révolution de masse, nous proposons de concevoir la révolution de masse en 4 phases, dont le prochain thread proposera une application au cas français de 1789 :
1)Phase unitaire ou de dé-institutionnalistion : phase à agenda négatif : se débarrasser de l’ordre existant sans discuter de ce qu’il faut construire (sinon aucune majorité n’est possible). C’est le 'regime change'.
2)Phase de polarisation : processus de variation entre tendances modérées et radicales. Moments d’opposition sur des problèmes fondamentaux comme les droits de propriété, la forme du pouvoir politique, etc. Processus instable, surtout si l’ordre ancien n’est pas vaincu.
3)Phase de domination : situation de révolution permanente avec radicalisation de l’agenda (démocratique/national vers égalitaire/socialiste). Conduit à la terreur contre les tenants de l’ancien régime mais aussi entre révolutionnaires.
Forte instabilité liée au décalage entre le pouvoir politique et militaire des leaders et leur manque de moyens économiques pour assurer leur domination. Cela peut conduire à institutionnaliser la guerre, avant la nécessaire chute du pouvoir.
4)Phase de restauration ou de ré-institutionalistion : consolidation des nouvelles institutions. La force brutale et l’expropriation ne sont pas suffisantes pour établir une société égalitaire, les radicaux sont évincés ou se déradicalisent (putsch ou embourgeoisement).
Le nouvel ordre social est un mélange de l’ancien et du nouveau, la restauration n’est pas complète. La restauration n’est pas la reproduction du passé de mais l’adoption d’un nouvel ordre social empruntant certaines formes traditionnelles.
Dans la deuxième partie (à venir), j’essaierais de montrer que la Révolution française est une révolution de masse car l’aristocratie a refusé le compromis avec la bourgeoisie – cette dernière venant chercher l’appui des masses… qui se sont dotées de leur propre agenda.

 Read on Twitter
Read on Twitter