 Thread Historique: Alger, une monarchie Collégiale (1515-1830), ou comment détruire le mythe de "L'Algérie: gouvernés par les Turcs et crée par la France"
Thread Historique: Alger, une monarchie Collégiale (1515-1830), ou comment détruire le mythe de "L'Algérie: gouvernés par les Turcs et crée par la France"
En dépit d'une évolution marquée vers un système monarchique, le pouvoir à Alger conserva, jusqu'à la fin, une structure collégiale. Elle fut doté d'un système de gouvernement en tous point comparable aux autres provinces Ottomanes dès 1515: un gouverneur (beylerbey),
un Odjak Janissaire, administré par une assemblée (diwan), renouvelée par un recrutement régulier d'homme de troupe (Yoldach) en Anatolie. Mais compte tenu de l'importance de la guerre de course qui se poursuivait contre les chrétiens, et qui, outre son aspect militaire et
religieux, contribuait à la richesse de l'Algérie, un rôle important fut joué par les corsaires (Reïs), organisés en Ta'ifa) dont la composition était sensiblement différente de celle de l'Odjak, car les Ottomans étaient moins nombreux que les convertis.
Après 1571 et, l'affaiblissement du pouvoir des Beylerbey, laissa le champs libre à la rivalité de pouvoir entre l'Odjak Janissaire et les Corsaires, on considère ceci comme le pivot de l'Histoire politique en Algérie. A cela il faut ajouté la classe des Kouloughlis:
enfant des janissaires ainsi que des femmes autochtones, que les janissaires essayaient d'écarter du pouvoir. Ainsi cette rivalité prit fin en 1658, lorsque la milice décida d'annuler le titre de Gouverneur et de le remplacer par l'Agha du diwan qui était nommé pour 2 mois.
Cette "république militaire" n'était pas viable, en 1671, 6 aghas furent nommés et déposés en 3 jours, et la milice confia donc le pouvoir au Dey, qui était nommé à vie et assuma la totalité du pouvoir. Mustafa Dey d'Alger de 1700 à 1705, annonçait ainsi son investiture à
Louis XIV: "Les officiers et Janissaires de l'armée victorieuse et les officiers du du diwan avec les principaux Seigneurs de la ville et du Royaume d'Alger, s'étant assemblés, m'ont tous, d'un commun accord, et d'une résolution unanime, installé à la dignité de Dey et Gouverneur
de la Ville et Royaume d'Alger". Ce nouveau régime de Dey fut d'abord très instable, entre 1671 et 1710, 13 Deys se succédèrent, et trois des 4 derniers furent assassinés, le quatrième échappant à un sort prévisible par un bannissement. Ali Tchavuch élu dey en 1711
procéda au dernier remaniement du système gouvernementale algérien, il refusa l'accès au pacha Ottoman à la ville d'Alger et demanda au Sultan Ahmed III d'être nommé lui même Pacha d'Alger, désormais la Porte n'avait plus aucun pouvoir en Algérie. Une tentative de restauration
Ottomane eut lieu en 1729, pour établir un nouveau pacha, mais elle échoua lamentablement. Il y a au XVIIIe siècle une certaine stabilité dans la régence, de 1710 à 1798, seuls 9 dey se succèdent, et seulement 3 gouvernent de 1754 à 1798. La succession devint régulière
le dey était choisi parmi les hauts dignitaires de l'Etat, en général le Khaznadji, mais aussi l'agha des spahi, ou le Khudjat Al Kheyl. Une évolution vers l'hérédité parait même s'être parfois ébauchée: Baba Ibrahim (1732-1745) était le beau frère de Kur Abdi (1724-1732) et
eut pour successeur son neveu, Ibrahim Kutchuk (1745-1748). Les règnes devinrent paisibles: sur 9 deys ayant régnés entre 1710 et 1798, sept moururent de mort naturelles, seuls deux furent assassinés, il ne se produisit guère qu'une "révolution" celle de 1754 pendant laquelle
la légende veut que 5 deys se soient succédés en un jour. Le dey gouvernait avec l'aide de conseils ou siégeaient les hauts dignitaires, les officiers de la milice, les ra'is et divers notables (Oulémas). Quelques hauts personnages constituaient un ébauche de gouvernement
avec des attributions relativement précises: Khaznadji (trésorier), premier en influence, et souvent successeur désigné du Dey; agha des spahis (Mahalla aghasi), qui commandait l'armée; Khudjat al Khayl, chargé des revenus des terres de l'état et de l'organisation des camps,
Bayt al Maldji, qui contrôlait les successions vacantes; Wakil al Khardj, chargé de la marine et, par extension, des affaires extérieures. Un personnel d'écrivain (Khudja) s'occupait du secrétariat et de différents "départements" administratifs et financiers.
Trois Bey gouvernaient les provinces (Oran, Titteri, Constantine), vers lesquelles étaient envoyés, chaque années, des camps (Mahalla) chargés d'aider au maintien de l'ordre; les provinces payaient un tribut annuel au bey. Ce système donna à l'Algérie un calme et
une prospérité réels, en particulier durant la seconde moitié du XVIIIe siècle: le long règne de Muhamed Ibn Uthman Dey (1766-1791) eut sont pendant à Constantine, qui connut son âge d'or sous Salah Bey (1771-1792), et à Oran avec Muhamed Bey al Kabir (1779-1796).
Venture de Paradis évoque les gens "vraiment vertueux" qui gouvernaient l'Algérie et décrit Muhamed Ibn Uthman comme "Un homme sobre, continent, chaste, modeste dans ses vêtements, ne respirants que pour la prospérité de l'Etat".
La régence s'imposait même à ses voisins: trois défaites infligées au Maroc de Mawlay Ismail avaient assuré la sécurité du côté occidental. A l'Est, la Tunisie subissait la domination algérienne, dont la supériorité s'était manifesté tout au long d'expéditions victorieuse.
La dernière, celle de 1756, permit le rétablissement de la branche légitime des Huseynite et réduisit les Tunisiens au statut de tributaires. A l'extérieur, les puissances européennes reconnaissaient l'autorité de la régence d'Alger et, plutôt que de recourir à des démonstrations
de force préféraient régler le problème par des traités où bien le paiement de tributs et cadeaux à l'Algérie. Deux évènements marquèrent de manière spectaculaire la puissance de l'Algérie:
- En 1775, l'expéditions lancée par les espagnols contre Alger, sous le commandement
- En 1775, l'expéditions lancée par les espagnols contre Alger, sous le commandement
d'O' Reilly (344 navires et 22.000 hommes de troupes), se termina dans la confusion des assaillants et confirma l'apparente invulnérabilité algérienne face à des attaques venues de la mer.
- En 1792, peu après la mort de Muhamed ibn Othman, Oran fut définitivement reprise
- En 1792, peu après la mort de Muhamed ibn Othman, Oran fut définitivement reprise
aux Espagnols.
Dans tout cela, les deys d'Alger se conduisaient en souverains tout à fait indépendants vis à vis de la porte. Certes, ils maintenaient des liens qui les unissaient à l'empire: ils y étaient incités par le sentiment de solidarité Islamique, par le prestige Ottoman,
Dans tout cela, les deys d'Alger se conduisaient en souverains tout à fait indépendants vis à vis de la porte. Certes, ils maintenaient des liens qui les unissaient à l'empire: ils y étaient incités par le sentiment de solidarité Islamique, par le prestige Ottoman,
pour la considération que l'empire représentait comme force utile dans des moments graves, et enfin par la nécessité de pouvoir recruter des troupes au Levant. Le dey nouvellement nommé sollicitait une investiture qui n'était donc JAMAIS refusée, et , pour bien disposer
le gouvernement Ottoman, il envoyait des cadeaux (tissus, objet de corail, esclaves...) qui quelles que fût leur valeur, ne constituaient pas un tribut régulier, et auxquels le sultan répondaient d'ailleurs par des présents utiles: canons, poudre en 1801; une frégate en 1817.
Le Dey s'adressait à la Porte avec une humilité affectée: écrivant au sultan en 1827, Hussein Dey s'intitulait "vizir délégué à la sauvegarde des intérêts de l'odjak victorieux de notre maître dont je ne suis que le serviteur" et signait "Serviteur Hussein, gouverneur de la
grande ville d'Alger, votre esclave". Le même dey envoya une aide au sultan au moment de l'indépendance grecque: huit de ses navires à Navarin. Mais dans le gouvernement de leur province, les deys ne toléraient aucune intervention de leur suzerain. En 1724, on apporta à Alger
un firman dans lequel le sultan invitait les algériens à restituer des bateaux enlevés à des armateurs impériaux. Au moment où les envoyés énuméraient les titres du Sultan et mentionnaient celui de "Roi d'Alger", le dey se leva, s'exclama "Comment, roi d'Alger, que suis-je donc?"
et sortit de la salle. Les bateaux ne furent pas rendus Lorsqu'en 1735, les algériens décidèrent d'intervenir en Tunisie contre Husseyn ibn Ali, en faveur d'Ali Pasha, la porte dépêcha à Alger un kapidji chargé d'interdire toute opération contre Tunis; le Dey ne tint aucun compte
de cette démarche, et le Kapidji fut finalement décapité. En 1798, Mustafa Dey éluda autant que possible l'ordre de Selim III de déclarer la guerre à la France; contrait de rompe à nouveau avec la France en 1801, il écrivit au premier consul Bonaparte pour s'excuser et
s'engagea à "Armée beaucoup de vaisseaux pour intercepter et brûler ceux que le Sultan dirigerait du côté de l'occident". Dans les dernières années du XVIIIe siècle, la stabilité relative que nous avons décrite prit fin, et la régence entra dans une période de crise qui allait
durer jusqu'en 1830. Bien avant l'intervention de Lord Exmouth en 1816, la course était devenu une activité économique négligeable et avait cessé de représenter une ressource de substitution pour un commerce médiocre. Les esclaves chrétiens, dont le nombre dépassait peut être
25.000 au milieu du XVIIe siècle, et 3000 en 1750, n'étaient plus que quelques centaines en 1830. La force militaire de la régence s'était affaiblie avec le déclin de la milice: entre 1800 et 1829, 8533 recrues seulement furent amenées du Levant. Une fermentation religieuse
vigoureuse se manifestait avec la création, ou la réforme, de nombreux ordres religieux (Tayyibiyya, Darqawa, Tijanniya, Rahmaniya) qui inspirèrent des mouvements de révoltes quasi constant, notamment en Kabylie (1803-1807 et 1810-1815) et dans l'Oranais (1820-1828).
La diminution des ressources fiscales amena les gouvernants à alourdir l'exploitation de la population, aggravant ainsi le mécontentement. L'indiscipline de la milice faisait d'autre part retomber le pouvoir dans une instabilité qui rappelait la période de la fin du XVIIe siècle:
entre 1798 et 1817, les 6 deys qui régnèrent successivement furent renversés par des révoltes de militaire et mis à mort. C'est sans doute en partie pour se soustraire à la pression de la milice que Ali Khudja décida, en 1817 de quitter le palais de la Djanina, dans le centre de
la ville et d'aller s'établir dans la Citadelle, sous la garde de 2000 Kabyles. Il fit savoirs aux Ottomans "Qu'il traiterait bien ceux qui consentiraient à obéir; il laissait les autres retourner au Levant, d'où il ne voulait plus tirer de recrues". Une tentative des Ottomans
pour déposer le Dey fut écrasée par une petite armée de 6000 Kouloughlis. Les janissaires perdirent 1200hommes et 150 officiers; ils demandèrent à être rapatrier au levant. La régence était entrain de se nationaliser. Mais il était bien évidement trop tard, son affaiblissement
intérieur comme extérieur fut mis en lumière. En 1807 une armée tunisienne mit le siège à Constantine et mit les troupes Algérienne en déroute. En 1816, Lord Exmouth vient, au nom des européens, imposer aux Algériens la fin de l'esclavage et de la course: le violent bombardement
d'Alger (50.000 boulets de canons en quelques heures) poussa le Dey à se réfugier dans la Casbah. La crise de 1830 mit en lumière, une dernière fois, le caractère ambigu des relations entre la régence et l'empire: une indépendance de fait, dans le cadre d'une vassalité réduite
à des formes extérieurs; mais aussi le sentiment de l'appartenance à une communauté dont le centre Ottoman pouvait être un ultime recours en cas de péril extrême. Au moins d'avril 1830, la porte envoya à Alger Tahir Pasha pour convaincre Husseyn Dey de donner à la France
les satisfactions qu'elle exigeait, de manière à éviter le déclenchement de l'expédition. Tahir Pasha était à Tunis les 8-12 mai; il arriva à Alger le 21; le commandant du blocus lui refusa le passage, car le corps expéditionnaire français était déjà embarqué (11-18 mai).
A ce moment où le destin d'Alger était sur le point d'être scellé, Husseyn Dey donna l'ordre de tirer sur la frégate de Tahir Pasha si elle tentait d'entrer dans le port. Mais la dernière lettre du dey d'Alger fut "un pressant appel à l'aide militaire de Constantinople".
Très significatif aussi furent les appels à l'aide lancés par Hajj Ahmed Bey de Constantine et la population de la ville à l'adresse de la Porte Ottomane, dernier rempart contre la conquête française. Le 3 août 1837, le bey s'adressait au Sultan: Nous avons formulé les vœux de
reconnaissance à Dieu lorsque Votre Majesté s'est occupée de nous et de ses serviteurs. L'ennemi de Dieu a marché contre nous. Nous n'avons pas la force de l'attaquer sinon grâce à l'aide de Dieu et celle de la Sublime Porte. Nous sollicitons que votre bienveillance s'occupe de
nous. Ce pays est le vôtre, ces gens sont les vôtres aussi, nous sommes de fidèles et obéissants serviteurs de Votre Majesté impériale". Le 13 octobre, les troupes françaises pénétrèrent dans Constantine.
 Voila fin du thread, merci à ceux qui ont lu jusqu'ici ! Et pardonnez moi les fautes d'orthographe et de syntaxes qui doivent être très nombreuses!
Voila fin du thread, merci à ceux qui ont lu jusqu'ici ! Et pardonnez moi les fautes d'orthographe et de syntaxes qui doivent être très nombreuses!
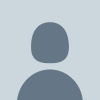
 Read on Twitter
Read on Twitter




