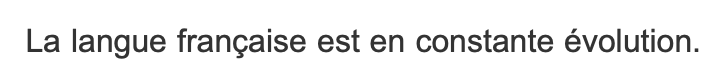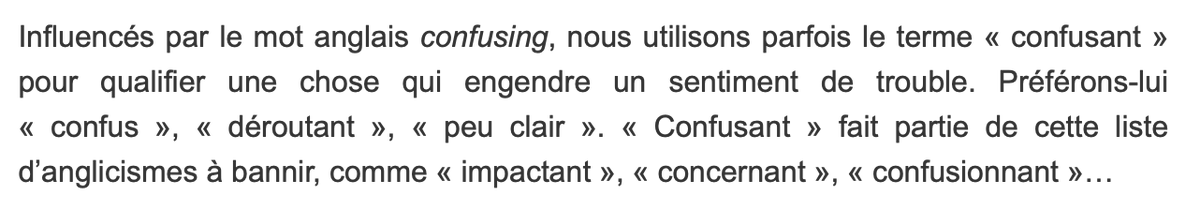Sous couvert d'érudition condescendante, cet écrivassier de @OuestFrance fait preuve d'une inculture linguistique crasse. https://ofr-ofa-primary-api.twipemobile.com/shared/?url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fleditiondusoir%2Fdata%2F104436%2Freader%2Freader.html%23!preferred%2F1%2Fpackage%2F104436%2Fpub%2F157297%2Fpage%2F15&description=%C2%AB%C2%A0Malaisant%C2%A0%C2%BB%2C%20%C2%AB%C2%A0candidater%C2%A0%C2%BB%2C%20%C2%AB%C2%A0chronophage%C2%A0%C2%BB%E2%80%A6%20On%20entend%20ou%20on%20utilise%20ces%20termes%20assez%20r%C3%A9guli%C3%A8rement.%20Ils%20ne%20figurent%20pourtant%20pas%20dans%20le%20dictionnaire.%20Anglicismes%20ou%20barbarismes%E2%80%A6%20Vous%20les%20connaissez%20forc%C3%A9ment.%20Tour%20d%E2%80%99horizon%20de%20ces%20n%C3%A9ologismes%20entr%C3%A9s%20dans%20le%20langage%20courant.&title=Dix%20mots%20qu%E2%80%99on%20utilise%20parfois%2C%20mais%20qui%20n%E2%80%99existent%20pas&image=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fleditiondusoir%2Fdata%2F104436%2FNextGenData%2FImage-1024-1024-15542029.jpg
"Le" dictionnaire, ça n'existe pas. Il y a DES dictionnaires, dont la fonction est d'enregistrer l'usage, pas de le prescrire.
Si on peut utiliser un mot, c'est qu'il existe. C'est la magie de la langue, une de ses dimensions performatives et poétiques (poétiques au sens de "créatrices") : il suffit de dire quelque chose pour que le mot soit créé. Qu'il soit accepté ensuite, c'est une autre histoire.
Évidemment l'article commence par "malaisant" : "Cet adjectif dérange parce qu’il est formé à partir du participe présent d’un verbe qui n’existe pas : malaiser." On l'a déjà dit dix fois : si, le verbe "malaiser" a bel et bien existé en français.
C'est ensuite "Candidater" qui subit l'ire de l'auteur, au prétexte qu'il ne figure pas dans "les dictionnaires". Et alors ? C'est un exemple de dérivation lexicale, processus de néologisation banal (l'anglais a le "verbing" plus facile que le français, mais il n'empêche !)
"Monétiser" ensuite : on lui donne "à tort" le sens de faire de l'argent, alors que son sens premier est de *littéralement* faire de l'argent (de battre monnaie). Donc je propose qu'on réserve le terme "voiture" à "une charge transportée sur un âne", qui était son sens originel.
L'auteur propose de le remplacer par "lucrativer", "très chic" selon lui : donc il y a les bons néologismes, et les mauvais néologismes. J'ai bon ?
Si vous n'aimez pas les anglicismes, je vous rappelle que vous pouvez aussi cesser d'employer les mots "club", "shampooing", "bar", "nord", "ouest", "budget", "film", "scoop", "media"...
"Nominé" serait à éviter pour les mêmes raisons : effectivement, on l'a emprunté à l'anglais dans le sens "désigné à un prix cinématographique", mais le verbe "nominer" existait depuis longtemps en français. Ça pose la question intéressante de ce qu'on peut considérer
comme de l'emprunt. Après tout, personne à ma connaissance ne se plaint qu'on utilise "allitération" alors que c'est un emprunt à l'anglais aussi !
"Fuiter" : "En vrai, on peut dire qu’il y a eu une fuite, mais on ne peut pas dire qu’une information a fuité". Si, la preuve, le journaliste le fait, et par ailleurs, on ne devrait pas avoir le droit de dire "en vrai" (voilà, moi aussi je peux le faire).
"« chronophage » n’existe pas dans la langue française." Euh... mais alors qu'est-ce qu'on fait de chronomètre, anthropophage, chronologique, cinématographe et tous ces trucs qui sont grecs et donc pas français ?
Enfin apparemment "gratifiant" est "une vilaine erreur de français". Il faudrait prévenir les gens au TLFi, du coup.
Je boucle la boucle : le terme "écrivassier" que j'employais en début de fil n'apparaît plus dans le TLFi. Dérivé au XVIIIe du verbe "écrivasser", il serait donc désuet. Les langues évoluent, et chaque locuteur ses idiosyncrasies. Une langue qui évolue, c'est une langue qui vit !

 Read on Twitter
Read on Twitter